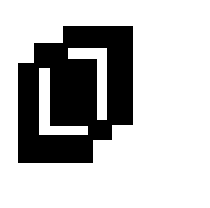Peau de peinture¶
Anatole habitait Paris avec ses parents. Le soir, il prenait son repas sur le balcon, au milieu des pots de fleurs et c’était à peu près la seule campagne qu’il voyait tout au long de l’année.
L’état, il reignait souvent une chaleur infernale. L’air était chaud. Les semelles de chaussures collait au goudron. Il fallait presque courir pour ne pas finir attraper par le trottoir, comme si la ville voulait nous retenir prisonnier.
Une fois, le sol avait tremblé. Un immeuble à quelques rues de là s’était écroulé. Une conduite de gaz avait eu la bonne idée de fuir, un mégot de cigarettes avait fait le reste. Notre-Dame avait pris feu aussi, elle avait inondé l’île principale de Paris d’un venin plombé.
Tout l’été, la ville avait des boutons de chaleur, des verrues sur les trottoirs, le goudron troué au scalpel puis raffistolé de pansements de pavés.
A la radio, les scientifiques disaient que chaque français mangeait l’équivalent d’une carte bleu de plastique chaque semaine. Anatole se demandait d’où il venait. Il avait beaucoup observé l’eau qu’il buvait, ses patates et son gâteau au chocolat mais rien qu’il ne puisse voir à l’oeil nu ne s’était laissé observé. Et pourtant, les scientifiques avait l’air sûrs d’eux, nous avions à table la salière, le poivrier et la plastiqueuse, un peu comme du fromage râpé.
Anatole faisait du sport une fois par semaine. Du foot. Il lui était difficile de s’en passer ou de passer l’invitation même si son cours avait lieu en plein soleil. Son nez n’avait pas beaucoup apprécié. Il s’était mis à peler quelques jours après. Agacé par ces petits bouts de peau, Anatole les grattait sans cesse. Il finissait un peu partout, dans le canapé puis dans les pots de fleur après que sa maman lui avait demandé de passer l’aspirateur car ce n’était vraiment pas poli de perdre sa peau là où tout le monde s’asseillait.
Anatole se pencha sur les fleurs. Après tout, sa peau était biodégradable. De ça, malgré le plastique invisible qu’il mangeait, il était à peu près sûr. Alors qu’il s’apprêtait à enfouir ses écailles de peau sous la terre, il en remarqua d’autres, brillantes, blanches, juste à côté. Mais qui pouvait avoir cette peau fragile et cassante ? Il demanda à sa mère si elle mettait du dentifrice dans les pots de fleurs pour éloigner les nuisibles. Sa mère haussa les épaules et se demanda d’où cette idée saugrenue pouvait bien lui venir.
Il revint au pot de fleur avec une loupe. Même grossi, ces petits trucs ne lui évoquait rien. Il prit alors des photos, puis encore des photos le lendemain et quasiment tous les jours. Certains jours, un triangle blanc poussait comme par magie, d’autres jours, une araignée le maintenait à distance.
Alors qu’il prenait un bain, il réflechissait à son énigme, les yeux rivés au plafond qui s’écaillait comme dans beaucoup de salle de bains parisiennes mal aérées. Lorsque sa mère ouvrit la porte, un courant détacha un petit bout qui tomba sur l’eau. Lorsqu’il essaya de l’attraper avec sa main, ce petit bout sa cassa en fine miette. C’est alors qu’il eut une idée.
Il sortit de son bain et se dirigea vers le balcon. Et au lieu de regarder le pot de fleur, il regarda au dessus de lui pour s’apercevoir que le mur de son immeuble avait lui aussi pris des coups de soleil et que sa peinture pelait tout plein. Anatole gratta le mur avec ses ongles. Il avait l’explication.
Et lorsque son père haussa le ton pour le réprimander car il était nu sur le balcon, et que son père avait légèrement glissé sur une de ses empreinte mouillée, c’est à peine qu’il le remarqua. Il dit simplement à son père : « j’ai compris ! » Ce message plein d’allant eut l’air de les satisfaire tous deux. Anatole s’essauya dans les rideaux. Et personne n’en parla plus.
Toute la ville pelait de partout, les murs, les rouillures d’escalier, la peinture des ponts, le béton des façades, le caoutchouc des pneus, la semelle des chaussures, sans compter tous les emballages qui échappaient aux poubelles, les masques victimes d’un gros éternuement, les vêtements qui s’usent. Tout ça, c’était du plastique. La peinture cachait les mêmes ingrédients que le plastique, la rouille cachait de l’anti-rouille, les pneus, et les semelles, les mégots aussi, tout ça c’était des petits bouts de riens du tout qui partaient dans le vent comme des pétales de pissenlits. Tout ça finissait broyé par le vent, plaqué au sol par la pluie, et le plus souvent quelque part loin, dans la forêt, dans un champ ou dans la rivière.
Pas étonnant qu’on en retrouve dans tout ce qu’on mange alors.
Anatole tenta vainement d’expliquer sa trouvaille à ses parents mais son histoire ne reçut qu’un écho limité. « Oui mais que peut-on y faire ? » lui rétorqua son père. Anatole dit simplement qu’il suffisait de ne porter que du coton, de chausser des espadrilles, d’arrêter la voiture, de bannir la peinture, d’arrêter de fumer.
Ses parents le regardèrent, hébétés. « Et comment peut-on faire ? On ne va quand même pas vivre dans une cabane de bois ? » Anatole ne voulait pas abandonner même s’il n’avait pas de réponse à ses problèmes. « Pas encore », pensa-t-il.
Là dessus, il dormit. Pas longtemps. Trop de choses à penser.
Le lendemain, au dîner, il leur dit solennellement, « Chers parents, chaque jour je m’empoisonne en buvant. Tout ça à cause de vous. Donc vous allez m’aider à réparer. Je veux devenir biologiste. » Ses parents ne comprenaient plus comment d’un bout de peinture dans un pot de fleur, Anatole en était à devenir biologiste. Il répondit gravement : « Maman, tu es médecin pour guérir les gens. Aujourd’hui le plus grand malade, c’est la nature. Alors je vais devenir médecin de la nature. »